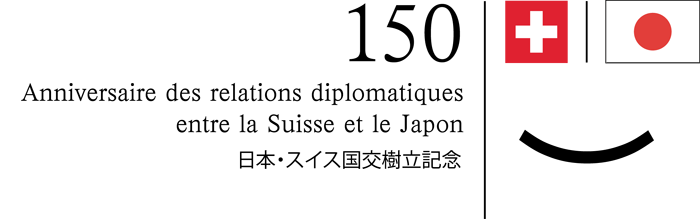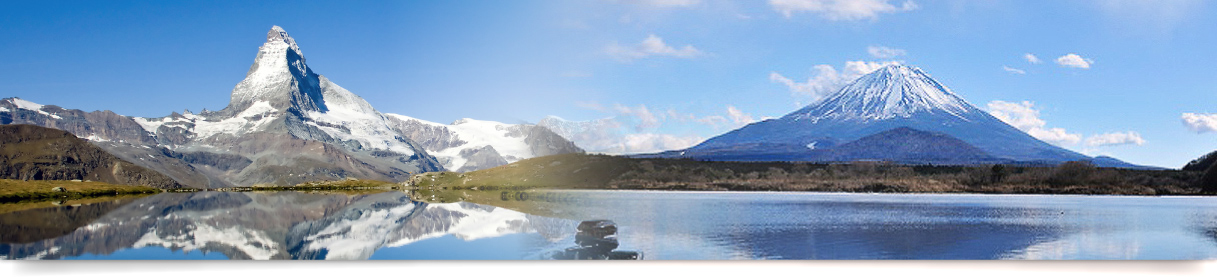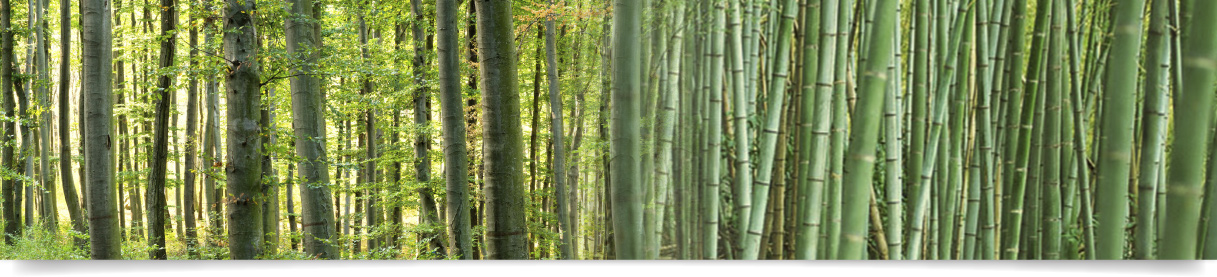150 ans de relations bilatÉrales Suisse – Japon. Et ensuite ?
Les relations bilatérales entre la Suisse et le Japon s'ouvrent un 6 février 1864, par la signature du premier Traité de Commerce et d'Amitié entre la Confédération Helvétique et le Taikun, c'est-à-dire le (14e et avant-dernier) Shôgun, Tokugawa Iemochi (1846-1866). Pour les Japonais de l'époque, ce jour particulier correspondait au 29e jour de la 12e lune de la 3e année de Bunkyû. C'est pourquoi le Japon et la Suisse s'apprêtent à célébrer en 2014 les 150 premières années de leurs relations bilatérales.
Quelles raisons avaient pu amener la Suisse, pays situé au centre de l'Europe, sans accès à la mer, sans marine ni colonies, à vouloir ouvrir des relations diplomatiques et commerciales avec le Japon, pays réputé isolationniste et situé à 9'674 kilomètres à l'est de Berne?
La Suisse et le Japon partagent plus d'une caractéristique similaire : un territoire accidenté, montagneux, dont seule une partie limitée se prête à l'agriculture, peu de ressources naturelles et une population diligente. Même si la Suisse n'est pas, ou relativement moins que le Japon, sujette aux séismes, les deux pays ont l'habitude d'une nature sévère, parfois cruelle, qui sait se faire respecter.
Après avoir pacifié sa dernière guerre civile, celle du Sonderbund, la Suisse de la seconde moitié du XIXe siècle vient de se donner en 1848 une constitution fédérale et entre dans une ère nouvelle, une phase de révolution industrielle et de forte croissance économique. Son industrie horlogère, en particulier, est à la recherche de nouveaux débouchés.
Le Japon de la toute fin de l'époque Edo (1603-1868) est en pleine ébullition. Le gouvernement shogunal est pris entre, d'un côté, une cour impériale peu disposée à l'ouverture du pays et des forces novatrices, visant à remplacer ce régime shogunal par un gouvernement impérial, et, de l'autre, les demandes de plus en plus pressantes des puissances étrangères pour l'ouverture du pays. Depuis l'arrivée du Commodore Perry et de sa flotte dans la baie d'Uraga en 1853 et le premier Traité de Commerce et d'Amitié avec les Etats-Unis d'Amérique de 1858, le gouvernement shogunal avait signé des traités similaires avec la Hollande, la Russie, la Grande-Bretagne et la France.
Les milieux industriels suisses sont très bien informés de cette évolution et invitent leur gouvernement fédéral à envoyer, en 1859 déjà, une première mission au Japon. C'est celle de Rudolf Lindau (1829-1910), qui reviendra avec la seule promesse de traiter la Suisse de manière prioritaire quand le Japon sera prêt à négocier de nouveaux traités.
C'est fin 1862 que le conseil fédéral nomme alors Aimé Humbert (1819-1900) comme Ministre plénipotentiaire avec pour mission de négocier un traité avec le Japon. Arrivé au printemps 1863, il faudra près d'une année à Aimé Humbert, et un coup de pouce diplomatique du ministre hollandais, Dirk Graeff van Polsbroek, pour obtenir enfin la conclusion du traité le 6 février 1864.
Le traité marque d'abord le début de nombreuses et fructueuses activités commerciales suisses, exportant vers le Japon armes, montres, instruments de précisions etc., et exportant vers la Suisse le précieux fil de soie. Les firmes commerciales Favre-Brandt, Sieber-Hegner, Liebermann-Wälchli, etc., s'établissent et commencent à prospérer à Yokohama, puis à Osaka-Kôbe.
En 1868, alors que le régime shogunal s'effondre pour faire place au nouveau régime impérial de l'ère Meiji (1868-1912), le Japon traverse une période de guerre civile à laquelle le transfert de la capitale de Kyôto à Edo, vite rebaptisée Tôkyô, met bientôt fin.
Le Japon commence alors, sous ce nouveau régime impérial, des réformes fondamentales, combinées à une occidentalisation de sa société. On parle souvent de la « restauration Meiji »; il s'agit en réalité d'une véritable « révolution » de la société japonaise. Les mesures gouvernementales d'abolition du système féodal, séparation du bouddhisme et du shintô, etc. ont alors des rebondissements jusqu'en Suisse. La cloche du Honsen-ji de Shinagawa en est un exemple. Elle fut saisie, puis exportée en Suisse, et sera en 1930 retournée à son temple par la ville de Genève, devenue propriétaire entre-temps, causant la naissance d'un lien d'amitié étroit entre Genève et Shinagawa formalisé en 1991. C'est un des multiples liens privilégiés qui lient aujourd'hui nos deux pays.
Alors que des produits suisses avaient trouvé le chemin du Japon déjà à l'époque Edo par l'intermédiaire de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, plusieurs producteurs suisses s'installent au Japon, tels Nestlé, CIBA (aujourd'hui Novartis), etc. dès le début du 20e siècle.
Les premiers Japonais à atteindre la Suisse sont les membres de la délégation japonaise présidée par le Prince Tokugawa Akitake (1853-1919) en 1867. Des étudiants, par exemple Ôyama Iwao, le futur maréchal, qui étudiât à Genève de 1870 à 1874, suivront. Un programme d'échange de bourses entre nos deux pays au niveau « post-gradué » continue aujourd'hui cette tradition. Première délégation officielle du nouveau régime impérial japonais, la célèbre Mission du Prince Iwakura Tomomi (1825-1883), lors de son tour du monde, visitera la Suisse en juin 1870, s'intéressant entre autres à la neutralité permanente, à la Croix-Rouge naissante et au système suisse de milice.
De la fin du 19e jusqu'au 20e siècle, le Japon se développe sur la scène internationale et alors que le monde s'enfonce dans la seconde guerre mondiale, les relations entre la Suisse et le Japon ne se sont jamais interrompues. Durant le conflit de la seconde guerre mondiale, sa neutralité permettra à la Suisse de représenter les intérêts alliés dans l'archipel.
Au mois d'août 1945, directement après le bombardement, le Dr. Marcel Junod (1904-1961) et les représentants du CICR entrent à Hiroshima et leur engagement au chevet des victimes marque le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales.
Très vite, les investissements et l'introduction de technologies suisses contribuent à la reconstruction du Japon. Avec l'intégration graduelle des marchés, les relations commerciales entre les deux pays se développent, entre complémentarité et sévère compétition, dans le domaine de l'horlogerie en particulier.
La situation spécifique de la Suisse, au centre de l'Europe, et néanmoins non-membre de la Communauté Européenne, incite nombre de compagnies japonaises à établir en Suisse leur centre de commande européen.
Le Japon et la Suisse, étant hautement dépendants des exportations, se voient donc épouser les mêmes valeurs libre-échangistes, tout en partageant des soucis concernant l'agriculture et le maintien d'une certaine autonomie dans le domaine de l'approvisionnement en denrées alimentaires.
Le récent Traité de libre-échange entre les deux nations, devenu effectif en 2009, est le témoin de cette communauté d'intérêts. Les échanges scientifiques et technologiques se sont intensifiés à travers les dernières décades entre nos deux pays.
Très tôt aussi, la beauté des paysages alpins attirent les touristes japonais vers la Suisse, au point que les avertissements de sécurité dans les trains de haute montagne sont souvent libellés en japonais.
De même que l'incendie en 1993 du pont de Lucerne avait ému les Japonais, qui contribuèrent généreusement à sa reconstruction, le récent cataclysme du 11 mars 2011 au Nord-Est du Japon et ses conséquences tragiques ont suscité un profond mouvement de solidarité en Suisse, renforçant les liens entre nos deux populations.
Une célébration telle celle du 150e anniversaire de nos relations bilatérales est l'occasion d'une réflexion sur le passé et d'une projection dans le futur. Sur la base de cette réflexion, quel rôle la Suisse et le Japon peuvent-ils jouer pour contribuer à la paix et la prospérité de notre planète ?
Philippe A. F. Neeser